Un regard sur le microcrédit
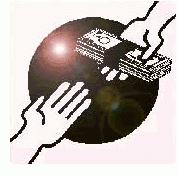
Le microcrédit s’impose désormais comme l’instrument privilégié de la lutte contre l’exclusion bancaire et la pauvreté. C’est d’ailleurs probablement pour cela que l’ONU a consacrée 2005 comme "année internationale du microcrédit".
Les institutions de microfinance offrent des services financiers aux populations qui sont dans l’impossibilité de réunir les conditions indispensables à l’octroi d’un prêt. Philantropie ? Je serais plus nuancé : ces institutions sont légalement reconnues mais ne font pas l’objet d’une régulation, ce qui leur permet de pratiquer un système de remboursement complexe qui peut créer mécaniquement des taux d’intérêt supérieurs à 50%...
Dans les pays en développement, plus de 80% de la population n’a pas accès aux banques. Et même si les études ayant pour objet d’évaluer les effets du microcrédit restent contradictoires, on sait que les impayés s’élèvent seulement à 1% ou 2%. Dès lors, les institutions de microfinance ont de l’avenir et on comprend leur intérêt pour les populations pauvres du Sud. Car l’ouverture de comptes-épargne permettrait la réinjection dans le système bancaire du "capital mort" et les services de transferts de fonds faciliteraient la transaction de centaines de milliards de dollars (envoyés chaque année par les émigrés à leurs familles).
Symbole d’une époque qui se cherche une conscience : en 2006, la Banque de Suède a attribué le prix Nobel de la paix à Muhammad Yunus, pionnier du microcrédit et fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh. Cet établissement est désormais une institution de microfinance de dimension internationale puisque la Grameen Bank ("banque du village") est implantée dans 60 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et qu’elle répond à la demande de 7 millions de clients auxquels elle a prêté 6 milliards de dollars depuis sa création, il y a 30 ans.
Mais qu’en est-il des bénéficiaires des microcrédits ? Sont-ils parvenus à sortir de la pauvreté en développant une activité économique pérenne qui leur permet de nourrir leur famille et d’élever durablement leur niveau de vie ?
Il est évident que la microfinance est un apport incontestable aux politiques sociales de développement mais ce n’est ni la seule solution ni le remède-miracle contre la pauvreté. Car si le microcrédit présente les symptômes d’une démocratisation de la finance (puisque les populations du Sud bénéficieraient des mêmes droits et services que celles du Nord), c’est surtout une occasion de promouvoir le Consensus de Washington, qui vise avant tout la libéralisation des marchés financiers... et qui est critiqué, entre autres, par le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz. En faisant un peu de mauvais esprit, on pourrait se demander si cette exportation de notre modèle économique n’est pas une autre façon de coloniser les continents.
D’ailleurs, depuis son apparition dans les pays industrialisés au début des années 1980, le microcrédit a connu une expansion de 67% par an en moyenne, notamment du fait du chômage de masse et du nombre élevé de petites entreprises. Et l’Union Européenne encourage ce développement avec un objectif avoué : la rentabilité financière.